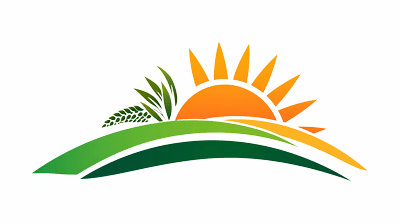Fin novembre, les jardins prennent une teinte de cuivre. Sous le soleil bas, les kakis brillent comme des lanternes suspendues. On croit toujours qu’ils sont mûrs, prêts à être cueillis. Mais c’est souvent là que tout se joue, et que la déception arrive. Un fruit trop tôt cueilli devient râpeux, presque âpre. Trop tard, il s’écrase, gorgé d’eau, et perd toute sa finesse. Entre les deux, il existe une fenêtre très courte où le kaki révèle enfin son goût doux et sa texture fondante. C’est cette marge de quelques jours qui fait toute la différence.
Ce fruit, si séduisant à l’œil, a la réputation d’être capricieux. En réalité, il obéit à une logique simple que peu de jardiniers prennent le temps de maîtriser : adapter la récolte à sa variété, à la météo et à la période. Une règle basique, mais déterminante, surtout autour du 25 novembre où les conditions deviennent imprévisibles.
Sommaire
Le faux ami des vergers d’automne : pourquoi le kaki devient-il immangeable ?
Dans les vergers, la confusion vient souvent du fait qu’il existe deux types de kakis. Les variétés astringentes, comme le Hachiya, regorgent de tanins : tant que la chair n’est pas presque liquide, elles sont immangeables. À l’inverse, les variétés non astringentes, comme le Fuyu, se savourent fermes, avec une chair croquante. La méprise entre les deux explique la majorité des récoltes ratées. Un Fuyu laissé trop longtemps se transforme en purée sans tenue ; un Hachiya cueilli trop tôt vous colle littéralement la langue au palais.
« Le kaki ne pardonne pas l’impatience : un jour trop tôt ou trop tard, et il devient inutilisable », confie Philippe Martin, jardinier amateur depuis vingt ans dans le Tarn.
À cette époque de l’année, l’arbre porte souvent encore des fruits durs tandis que d’autres commencent à ramollir. Ce décalage naturel déroute ceux qui veulent tout récolter d’un coup. Or, la maturité ne se lit pas seulement à la couleur : elle se sent, elle se pèse. Un kaki prêt à être cueilli devient légèrement souple sous les doigts, sa peau prend un éclat chaud et lisse, presque transparent pour les variétés astringentes.
Fin novembre : faut-il encore cueillir ou laisser mûrir sur l’arbre ?
À la fin du mois, tout dépend du climat local. En zone douce, les fruits peuvent rester sur l’arbre jusqu’à début décembre ; ils se gorgent alors d’un sucre incomparable. Mais dans les régions plus froides, il faut anticiper : une seule gelée suffit à altérer leur texture et à provoquer des taches noires irréversibles. C’est pourquoi beaucoup de jardiniers cueillent autour du 25 novembre, juste avant le premier froid durable.
Un autre facteur entre en jeu : les oiseaux. À cette période, quand les feuilles ont presque toutes chuté, les kakis deviennent des cibles faciles. Merles, étourneaux et pies percent la peau avant même que le fruit soit mûr. Pour éviter de perdre la récolte, mieux vaut cueillir légèrement avant maturité complète et laisser finir le processus à l’abri.
« Un coup de gel et c’est foutu pour la conservation », avertit un jardinier du nord de la Drôme, qui rentre désormais tous ses fruits avant la Saint-André.
Faire mûrir les kakis à l’intérieur : la méthode des jardiniers avertis
Pour les variétés astringentes, tout se joue après la récolte. La technique la plus utilisée consiste à enfermer les fruits avec quelques pommes ou bananes mûres dans une boîte hermétique ou un grand sac en papier. Ces fruits dégagent naturellement de l’éthylène, un gaz qui accélère la maturation et adoucit la chair. En trois à cinq jours, le kaki devient fondant, sucré, et perd son amertume.
Certains préfèrent une méthode plus lente : placer les fruits dans une cagette, sans qu’ils se touchent, dans une pièce à température stable. Cette maturation « douce » permet d’obtenir une texture veloutée et un goût plus complexe. Mais attention : au moindre choc, la chair se liquéfie. D’où l’importance de manipuler les fruits avec des gants fins et de les poser sur un lit de papier absorbant.
Les bons gestes à adopter pour préserver la récolte
Les erreurs de manipulation sont souvent fatales. Tirer le fruit pour le détacher, le tordre, ou le laisser tomber au sol provoque des microfissures invisibles. Ces blessures accélèrent l’oxydation et la fermentation. Le bon réflexe : couper au sécateur en conservant un petit morceau de pédoncule. Les fruits se stockent ensuite à plat, jamais empilés, dans une caisse ajourée.
Certains jardiniers recommandent même d’attendre une journée sèche avant de récolter. L’humidité, surtout en novembre, favorise les champignons et réduit la durée de conservation. Cueillir un fruit sous la pluie, c’est souvent le condamner à noircir avant la fin de la semaine.
« Depuis que je respecte cette règle, je ne perds plus un seul kaki »
Alain, à Carpentras, en a fait l’expérience : « Avant, je cueillais tout avant les gelées, sans distinguer les variétés. Résultat : la moitié de mes fruits étaient durs comme du bois, l’autre moitié écrasée. Depuis que je laisse mûrir les Hachiya sur l’arbre et que je cueille les Fuyu fermes, je ne jette plus rien. » Il rentre désormais ses fruits à la fin novembre, les dépose dans des cagettes avec deux pommes, et obtient une maturité parfaite en moins d’une semaine.
Nos lecteurs ont apprécié : Les Français cueillent leurs kakis trop tôt : voici la période idéale selon les variétés
Et vous, comment réussissez-vous vos récoltes de kakis ?
Le kaki demande de la mesure : ni précipitation, ni oubli. Entre le geste sûr et l’observation du fruit, c’est une affaire de rythme et d’attention. Chaque arbre, chaque automne, a son tempo. À cette période charnière de l’année, un simple coup d’œil à la météo ou une journée d’attente peut tout changer. Et vous ? À quelle date cueillez-vous vos kakis, et avec quelle méthode ? Partagez vos retours : c’est souvent d’une expérience voisine que naissent les plus belles récoltes.
Mis à jour le 25 novembre 2025